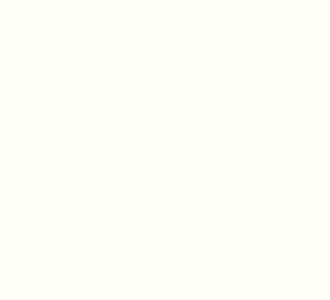Henry Laurens, prix Phénix 2019. Photo DR
Le prix Phénix de littérature 2019 a été décerné en janvier 2020 à l’historien français pour son ouvrage « Orientales » (CNRS éditions, 2019), qui réunit une quarantaine d’années de recherches de l’un des plus grands spécialistes vivants du Moyen-Orient.
Celui qui est actuellement professeur au Collège de France et à l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) précise dans la préface de son œuvre que les différents textes rassemblés sont « tout aussi bien des éléments d’une biographie intellectuelle que de l’expression de différentes demandes, allant de celles de l’académique à celles de la politique et de la société ». « Orientales » offre à son lectorat, érudit ou non, un outil de travail et de réflexion précieux, qui propose des clés de compréhension du monde arabe, de ses liens avec l’Occident et de ses enjeux contemporains, par une mise en perspective historique, politique, sociétale et artistique. L’ancien directeur du Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain (Cermoc) à Beyrouth précise que « ces recherches sont à la confluence de l’histoire intellectuelle, de l’histoire comparée et de celle des relations internationales ». L’historien a insisté sur sa « grande joie » d’être le lauréat du prix Phénix de littérature 2019, qui lui sera remis le 14 mars 2020, dans le cadre du Salon du livre d’Antélias, où se tiendra également une conférence en hommage à son œuvre.
Joséphine HOBEIKA | OLJ Avez-vous des liens privilégiés avec Le Liban ?
J’ai une épouse libanaise, depuis plus d’une trentaine d’années. La première fois que je suis allé au Liban, c’était en 1977, et je suis l’évolution de cette société depuis. J’ai beaucoup d’amis libanais, en fait je suis un Libanais d’adoption. J’ai été directeur du Cermoc entre 2001 et 2002, puis nous avons fusionné pour former l’Institut français du Proche-Orient, où j’ai été directeur scientifique pour le contemporain entre 2002 et 2003. J’ai ensuite quitté mon poste, car je venais d’être élu au Collège de France.
Pourquoi définissez-vous « Orientales » comme une « biographie intellectuelle » ?
L’ouvrage fut réalisé en plusieurs étapes : il y a eu une première édition en 2003, qui était en trois volumes, puis il y a eu un quatrième volume. Et maintenant on a une version unique avec les quatre volumes réunis.
Les premiers textes des Orientales datent du début des années 1980, il s’agit donc de la synthèse d’un travail intellectuel de 40 ans. On peut, en feuilletant les quatre volumes, voir l’évolution d’une réflexion et l’approfondissement de certains thèmes.
La première partie du volume, « Orientales I », est centrée sur l’expédition en Égypte de Napoléon. S’agit-il d’un personnage central dans le développement de l’orientalisme ?
Napoléon Bonaparte possède la science orientaliste de son temps, parce que c’est un grand lecteur et, depuis sa jeunesse, il a lu les principaux orientalistes français. Il les connaît personnellement et il fait la synthèse des travaux orientalistes du XVIIIe siècle dans son action, plus que dans sa réflexion. Si on reprend ses textes de sainte Hélène, on y trouve des éléments très intéressants sur le monde musulman.
On lui a attribué un projet d’État juif, et il y a encore des Israéliens qui y tiennent, mais cela ne correspond à rien. Il n’y a rien dans les archives ou les sources originales qui permettent de le confirmer. Dire qu’il était antisémite serait un peu anachronique, mais il n’aimait pas tellement les Juifs, il préférait nettement les musulmans et les chrétiens.
La notion d’orientaliste est transversale dans votre ouvrage. Vous définissez-vous comme un orientaliste ?
Dans le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, on trouve pour orientaliste : « Homme qui a beaucoup voyagé »... Mais je défends l’orientalisme, un orientalisme au sens classique, tel qu’il s’incarne au XIXe siècle, c’est-à-dire d’abord un travail de philologues, qui ont une connaissance linguistique extrêmement développée de plusieurs langues orientales. En somme, je suis un historien de l’orientalisme.
Quand est apparu l’orientalisme en Europe ?
Il faut distinguer l’orientalisme scientifique, celui de l’histoire des sciences sociales, de la philologie, de la traduction littéraire, et l’orientalisme artistique. Ce dernier est un mouvement lié au romantisme européen, qui a donné de très belles œuvres, en peinture notamment, avec Delacroix par exemple, ou des peintres plus secondaires mais tout à fait intéressants, comme Étienne Dinet pour l’Algérie.
L’orientalisme au sens scientifique du terme commence dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en Europe, et en particulier en France. C’est avant tout un mouvement littéraire, dont le but est de traduire les textes orientaux pour enrichir la littérature, jusque-là composée des écrits des Anciens et des Modernes, et pour constituer une sorte de littérature universelle. L’exemple parfait est la traduction au début du XVIIIe siècle des Mille et une nuits en français, ensuite dans les principales langues européennes. Ceci a enrichi considérablement la culture européenne.
Puis on a une deuxième période au XVIIIe siècle, qui est la naissance de la comparaison : l’orientalisme de la seconde moitié du XVIIIe siècle en particulier devient extrêmement comparatiste et s’ancre aussi dans un projet d’histoire universelle, qui devient assez rapidement centré sur l’Europe, présentée comme étant à la tête de l’humanité. Vous avez un excellent portail d’orientalisme dans le site de la Bibliothèque nationale de France, qui regroupe des ouvrages consacrés à l’Orient arabe jusqu’au début du XXe siècle.
À quel moment l’orientalisme artistique se développe-t-il ?
Au XIXe siècle, le mot orientalisme apparaît, et l’orientalisme artistique se développe. La dimension philologique reste absolument essentielle, c’est à la fois l’acquisition du patrimoine littéraire et philosophique des civilisations orientales, avec énormément de traductions et de sauvetages de textes. C’est aussi de l’archéologie puisqu’il y a un orientalisme consacré à l’Antiquité qui se développe, avec la découverte de toutes les civilisations antiques, et surtout le déchiffrement des écritures anciennes, hiéroglyphiques, cunéiformes, etc. C’est donc un immense mouvement intellectuel et artistique, évidemment en liaison également avec l’expansion coloniale de l’Europe. En effet, il faut donner aux coloniaux un savoir sur les sociétés que l’Europe est en train de dominer. Il se construit un savoir particulier, au service des administrations coloniales.
Dans quelle mesure l’orientalisme artistique est-il un outil de travail pour l’historien ?
Il convient de noter qu’en France par exemple, les relations de voyage sont très anciennes. Il y a des voyages en Orient depuis l’époque médiévale, mais au départ il s’agissait de récits de pèlerinage à Jérusalem. Au XIXe siècle, naît un art littéraire : le voyage en Orient ; c’est Chateaubriand qui l’inaugure avec son Itinéraire de Paris à Jérusalem. On a ensuite Flaubert, Lamartine, Nerval, qui développeront cet art du voyage en Orient, qui n’est plus une simple narration comme dans les siècles précédents, mais un genre littéraire en soi. Et vous avez aussi l’équivalent de l’orientalisme pictural dans la littérature : Salammbô de Flaubert en est un bon exemple.
Pour un historien, tout document, quel qu’il soit, est une source. C’est intéressant de voir la relation entre l’orientalisme scientifique et l’orientalisme artistique, puisque les uns s’alimentent des autres. Il faut bien comprendre qu’à l’orientalisme correspond un occidentalisme, qui s’opère dans le sens inverse, et qui est au moins aussi puissant que l’autre. Mais on travaille peu sur l’occidentalisme.
Comment décrire l’évolution des liens culturels entre Orient et Occident ?
Ces liens sont très riches. Il y a à la fois des situations de domination, c’est évident, en particulier sur la période coloniale, ainsi que des échanges, depuis l’époque la plus ancienne. Il y avait déjà des Phéniciens en Gaule, même avant l’arrivée des Romains. Je pense que la culture française et la culture arabe sont entrées en résonance, et qu’il y a eu des échanges culturels absolument intenses entre les deux.
Le monde arabe, dans sa globalité, est probablement la zone du monde où le bilinguisme, ou même le trilinguisme, est le plus élevé. Et en ce sens-là, si vous comptez l’Afrique du Nord, la langue française est une des langues d’expression du monde arabe et de la culture arabe contemporaine. Il suffit de voir le grand nombre d’écrivains arabes s’exprimant en français, au Liban en particulier.
L’une des sections d’« Orientales III » s’intitule « Le Liban, la Méditerranée, l’Occident : récit d’un parcours ». L’ancrage identitaire complexe du Liban est-il l’un des fondements de son instabilité ?
Sur la période récente, c’est-à-dire presque sur les deux derniers siècles, le Liban est une réalité multiple, au sens où vous avez le petit territoire libanais, et une diaspora sur plusieurs continents, avec plus de Libanais ou de gens d’origine libanaise dans le monde que dans le Liban proprement dit. De ce point de vue, la richesse exceptionnelle du Liban réside dans sa diaspora, dans sa culture et dans ses instruments de modernité, ses écoles, ses universités, etc.
Le paradoxe libanais, c’est que d’un côté le pays peut être provincial : on peut avoir deux villages à dix kilomètres de distance qui se considèrent presque comme des étrangers entre eux, et en même temps, dans chacun des villages, vous avez de la famille sur trois continents. Donc à la fois le plus grand renfermement sur soi-même et la plus grande ouverture sur le monde, c’est peut-être ça le paradoxe libanais.
En quoi « La mission en Phénicie d’Ernest Renan », qui fait l’objet d’une des sections d’« Orientales IV », est-elle essentielle dans la culture libanaise ?
C’est à partir de Renan, pas à cause de lui, que l’on commence à avoir une connaissance scientifique des Phéniciens, parce qu’il participe à la première grande campagne archéologique qui les concerne. Il faudra attendre ensuite le mandat pour qu’on ait des fouilles systématiques pour l’époque phénicienne. Donc quand les Libanais parlent de « nos ancêtres les Phéniciens » à la fin du XIXe siècle, ils s’appuient sur les travaux de Renan.
La notion de « phénicisme libanais » que vous développez également dans « Orientales IV » a-t-elle été instrumentalisée ?
Si le phénicisme veut dire ouverture sur le monde extérieur, sur le monde du commerce et de l’entreprise, cela correspond à une réalité au Liban. Le pays s’identifie à la Phénicie, dans la mesure où elle est une représentation du Liban depuis 1850 à peu près. Opposer arabisme et phénicisme, c’est de la politique, ce n’est pas du réel, au sens où vous pouvez avoir une identité culturelle qui ne prend pas nécessairement le sens d’une identification politique, ou d’un projet politique. L’Amérique latine est espagnole, sauf le Brésil, mais ils ne veulent pas faire un grand État de langue espagnole. Il faut distinguer l’arabité du Liban et un projet politique d’arabisme. On n’est pas condamné à avoir un projet politique, parce qu’on a une identité culturelle.
Quel est le sens du titre de l’une des sections d’« Orientales IV », « Les historiens et le Liban : une mise en récit ou une fuite en arrière » ?
C’était intéressant de noter la mise en arrière des spécialistes du Liban et surtout des historiens libanais qui se sont peu consacrés à l’historie de la guerre civile, pour plutôt essayer d’en rechercher les origines, y compris jusque dans un long XIXe siècle.
Le sujet reste encore brûlant dans la société libanaise, et une bonne partie de la classe politique libanaise d’aujourd’hui est encore composée des chefs de guerre de la guerre civile. Même s’il y a eu des réconciliations, il y a quand même des traces absolument profondes. Et je note que ceux qui parlent de la guerre, ce sont les artistes, les écrivains, mais pas les hommes politiques. Vous avez des représentations de la guerre dans le domaine de l’art, du théâtre en particulier, mais pas dans le discours politique.
Que ce soit au Liban ou à l’étranger, vous avez peu de spécialistes qui se penchent sur ce sujet-là, l’histoire du Proche-Orient est d’une richesse prodigieuse, et le nombre d’historiens professionnels qui s’y consacrent dans cette période est relativement faible. Nous courons au plus pressé, et n’avons encore qu’une connaissance très faible, au sens historique du terme (c’est-à-dire un travail à partir d’archives, de recoupements...), d’épisodes entiers de l’histoire de la guerre civile libanaise, tout simplement parce que nous sommes très peu nombreux !
« Orientales IV » se termine par une partie sur le printemps arabe, que vous envisagez comme un « séisme tectonique ». Quelle est votre approche des événements actuels au Liban ?
Ils nous indiquent déjà que les mouvements de contestation ne sont pas terminés, car on pensait qu’ils avaient été étouffés. Or ils ont repris, en Irak, au Soudan, en Algérie et au Liban, donc c’est déjà une signification qu’il y a une demande populaire extrêmement forte. Au Liban, ce n’est pas tant un système de dictature qui est remis en cause, parce qu’il n’y a pas de dictature au Liban, mais plutôt l’impuissance de l’État.
Je crois que ce qu’on a partout dans le monde arabe, du Golfe à l’océan, c’est une demande populaire de droits politiques et de droits sociaux. Même s’ils ont maintenu des formes ouvertes de pluralisme politique, cela n’a pas permis cette décence de vivre correctement qui est le souhait profond des gens de la région. Dans les mouvements révolutionnaires européens, la révolution c’était pour construire un monde meilleur, c’était une utopie politique : on voulait faire un homme nouveau sous la Révolution française, ou sous la révolution russe. Les révolutions arabes d’aujourd’hui, c’est le contraire. Elles veulent que les gens puissent vivre normalement, avec des droits politiques, des droits sociaux, des États de droit, sans corruption. Ce sont des révolutions paradoxales, que l’on pourrait appeler paradoxalement des révolutions de la normalité, et non de l’utopie. Ou alors il faudrait considérer qu’être normal est un
.png)
.gif)